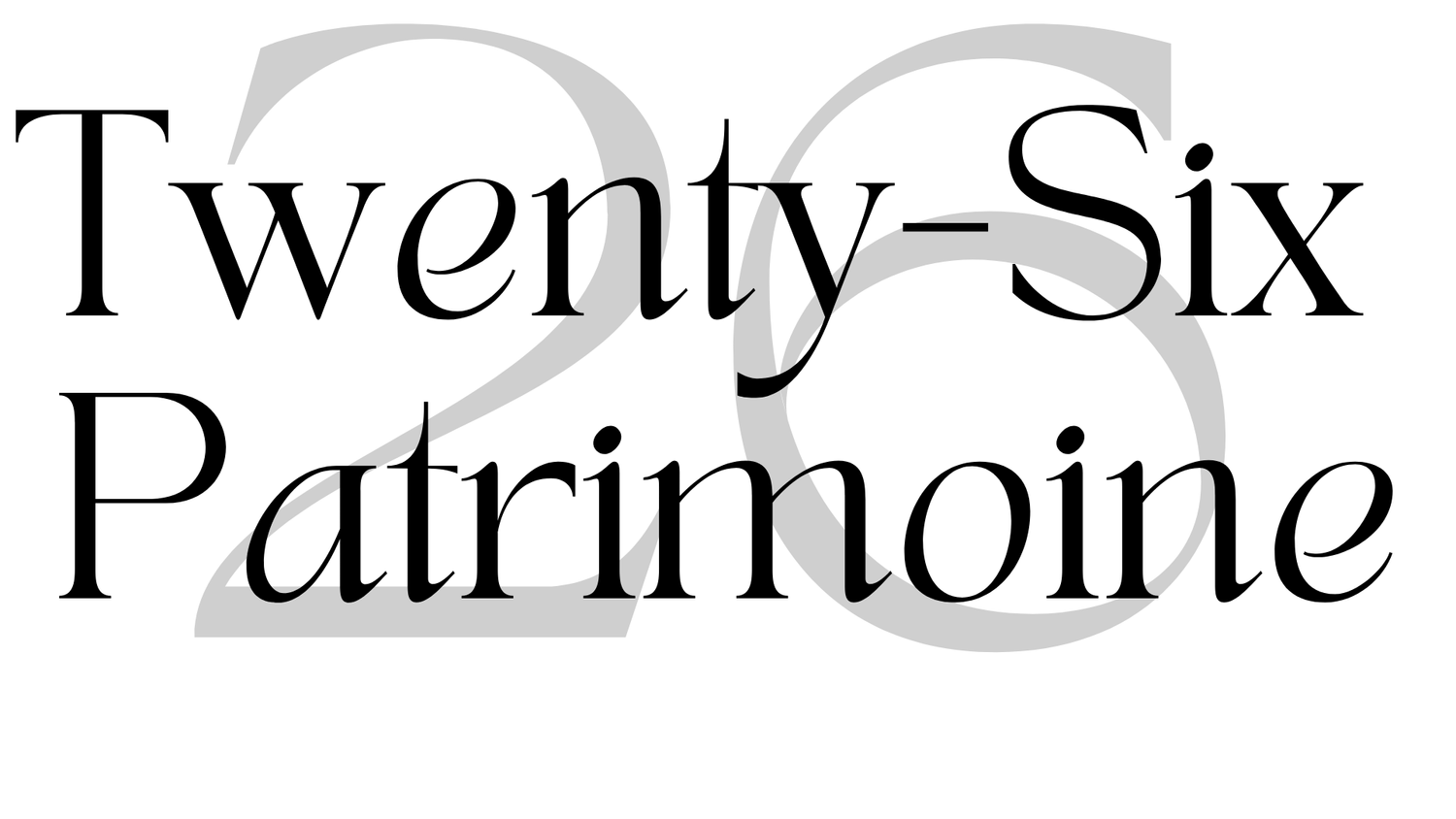L'Hebdo #154 : Jusqu'où ira le bull market et que contient vraiment le nouvel amendement sur le statut du bailleur privé ?
📈 Les news qui ont fait bouger les marchés cette semaine
1. Baisse de taux en vue et inflation maîtrisée
L’inflation américaine ressort à 3,0 % sur un an (contre 3,1 % attendu), ce qui renforce nettement le scénario d’une baisse de 25 pb de la Fed mercredi. Dans ce contexte, Wall Street revient au contact de ses records (S&P 500 +1,9 % sur la semaine), malgré le brouillard statistique lié au shutdown. Le message implicite du marché est simple : la désinflation reste compatible avec la croissance bénéficiaire, d’où un appétit pour le risque préservé. Les secteurs sensibles aux taux (tech “IA”, consommation discrétionnaire, industriels de qualité) concentrent les flux. À suivre : la réaction des taux réels après la décision de la Fed et la lecture des PMI d’octobre, qui donneront le tempo pour la fin d’année. Un chiffre d’inflation “conforme mais pas chaud” enlève une épine du pied aux actions et stabilise le dollar (EUR/USD autour de 1,16).
2. Commerce, énergie et or : détente sélective, tensions persistantes
L’annonce d’une rencontre Trump–Xi le 30 octobre soulage temporairement le risque de guerre commerciale, mais la fermeté américaine vis-à-vis de Moscou (sanctions sur Rosneft et Lukoil) maintient une pression haussière sur l’énergie : Brent +6,6 % hebdo (≈ 65 $), WTI dans la même veine. Cette combinaison “espoir sur le commerce + tension géopolitique énergétique” a déclenché une respiration de l’or, après un rallye parabolique : -3,1 % sur la semaine autour de 4 108 $/oz. Le mouvement ressemble à des prises de bénéfices plus qu’à un changement de régime : l’or reste largement en hausse depuis le début d’année, mais sa volatilité s’est rapprochée de celle d’un actif risqué. À court terme, l’axe Trump–Xi–semi-conducteurs restera le baromètre des techs asiatiques, tandis que le pétrole réagira aux signaux d’offre russe et à l’élasticité de la demande.
3. Résultats et rotation : Paris se redresse, la tech vacille
La saison des T3 dicte les variations. En Europe, l’indice large Stoxx 600 +1,7 % ; à Paris, CAC 40 +0,63 %, porté par le luxe (Kering +7,1 %, L’Oréal en soutien) et par des surprises positives (Edenred +25,5 % après publication et partenariat). À l’inverse, la tech française corrige nettement (STMicro −13,2 %, Dassault Systèmes −12,4 %), illustrant une rotation au profit de valeurs cycliques et de qualité perçues comme “IA-exposées”. Les États-Unis demeurent la locomotive (S&P 500 +1,9 %), mais l’écart intra-Europe persiste : Paris surperforme quand Francfort souffre des dégagements sur défense/banques. Les prochains jours concentrent les méga-caps US (Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta) et de grands noms européens ; la dispersion restera élevée : de +20 % à −20 % en séance selon la tonalité des guidances, avec un biais favorable aux dossiers affichant marges résilientes et cash-flow lisible.
📰 Le dossier de la semaine : Marchés actions, trois ans de hausse ininterrompue, jusqu’où ira le bull market ?
Trois ans après le point bas d’octobre 2022, la Bourse américaine continue de surprendre par sa résistance. L’indice S&P 500 a gagné près de 90 % en trois ans, soit près de 98 % en tenant compte des dividendes.
Un parcours impressionnant, certes, mais pas inédit : dans l’histoire moderne, les marchés haussiers ont souvent duré cinq ans ou plus, avec des performances doublées en moyenne.
Pour autant, le contexte n’est pas sans zones d’ombre : tensions commerciales ravivées avec la Chine, ralentissement du marché du travail et valorisations proches des sommets du cycle rappellent que la prudence reste de mise. La question n’est donc pas tant de savoir si le bull market va s’arrêter, mais plutôt quelle forme prendra sa prochaine phase de croissance.
Trois ans de hausse : un cycle solide mais encore jeune
Depuis le creux d’octobre 2022, marqué par une inflation à son pic et des marchés en repli de 25 %, les actions américaines ont connu une reprise spectaculaire.
La dynamique s’est accélérée dès la fin de l’année, portée par le lancement de ChatGPT et l’explosion de la thématique intelligence artificielle, qui a dopé les valeurs technologiques et tiré les indices vers de nouveaux records.
Historiquement, les cycles haussiers qui franchissent le cap des trois ans ne sont pas à leur crépuscule. Sur les douze bull markets observés depuis 1945, la durée moyenne est de cinq ans pour un gain total d’environ 200 %. Huit d’entre eux ont même dépassé la barre des trois ans, le plus long, celui né de la crise de 2008, ayant duré onze ans.
Autrement dit, le cycle actuel n’est pas encore vieux. Il se situe à mi-parcours, soutenu par un environnement monétaire en voie d’assouplissement et par une économie américaine qui, malgré quelques signaux de ralentissement, conserve un rythme supérieur à la moyenne des décennies passées.
Inflation apaisée : la Fed en soutien du marché
La publication du dernier indice des prix à la consommation (CPI) a confirmé la désinflation en cours aux États-Unis. En septembre, les prix n’ont progressé que de 0,3 % sur un mois et de 3 % sur un an, contre 3,1 % attendu. L’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) n’a augmenté que de 0,2 %, son rythme le plus faible depuis trois mois.
Ces chiffres, conjugués à un marché de l’emploi qui montre des signes de modération, devraient ouvrir la voie à une nouvelle baisse de taux de la Réserve fédérale le 29 octobre, ramenant la fourchette des fed funds entre 3,75 % et 4 %.
Une nouvelle détente monétaire pourrait suivre en décembre, prolongeant un cycle d’assouplissement qui devrait s’étendre jusqu’en 2026.
Signe supplémentaire de ce virage : la Fed pourrait bientôt annoncer la fin de son programme de resserrement quantitatif, c’est-à-dire l’arrêt progressif de la réduction de son bilan. Ce changement de cap viendrait renforcer le soutien monétaire aux marchés actions, déjà porté par la baisse des taux.
En clair, la politique de la Fed ne freine plus le marché haussier ; au contraire, elle pourrait bien en être l’un des moteurs principaux dans les mois à venir.
Des bénéfices appelés à prendre le relais
Si les valorisations boursières atteignent aujourd’hui des niveaux élevés, le S&P 500 se traite à plus de 21 fois les bénéfices attendus, la poursuite de la hausse dépendra désormais de la croissance des profits.
Les investisseurs semblent l’avoir compris : la nouvelle phase du bull market reposera moins sur la réévaluation des multiples et davantage sur la progression des résultats des entreprises.
La saison des publications du troisième trimestre confirme d’ailleurs cette tendance. Les premières sociétés ayant communiqué affichent une rentabilité solide, malgré le ralentissement économique et les tensions commerciales.
Parmi les sept géants technologiques (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla), la croissance des bénéfices devrait atteindre +15 % sur un an, contre +6,7 % pour le reste du S&P 500.
L’ensemble de l’indice affiche ainsi une progression moyenne de +8,5 % des profits, selon FactSet.
Les dirigeants évoquent une consommation toujours soutenue, notamment chez les ménages aisés, une qualité du crédit stable et une reprise des opérations de fusion-acquisition.
Surtout, les investissements dans l’intelligence artificielle continuent de croître à un rythme impressionnant : près de 400 milliards de dollars devraient être consacrés à ce secteur en 2025, soit un tiers des dépenses d’investissement totales des entreprises du S&P 500.
Vers un leadership plus diversifié
La question clé des prochains mois sera celle de la rotation sectorielle. Jusqu’ici, la performance du marché a été tirée par une poignée de valeurs technologiques (les fameuses « Magnificent 7 »), concentrant à elles seules plus de 30 % de la capitalisation de l’indice.
Mais les opportunités se déplacent. Les secteurs cycliques (industrie, consommation discrétionnaire) reviennent en force, portés par la détente monétaire, tandis que la santé, longtemps délaissée, retrouve un attrait défensif.
Les valeurs moyennes et petites capitalisations internationales présentent également un potentiel de rattrapage après des années de sous-performance face aux mégacaps américaines.
Sur le plan géographique, les marchés émergents bénéficient d’une stabilisation du dollar et d’un regain de flux d’investissement étrangers. L’Europe, elle, pourrait tirer profit d’un éventuel redressement de la demande mondiale en 2026.
Un marché haussier, mais plus exigeant
Le bull market a désormais trois ans, et il entre dans une phase plus sélective. Les indices pourraient marquer des pauses techniques après plus de cent jours sans correction de 5 %.
Les prochaines semaines s’annoncent d’ailleurs chargées : publication des résultats des grands groupes technologiques, échéances commerciales avec la Chine et le Mexique, négociations sur les tarifs douaniers… autant d’événements susceptibles de provoquer des à-coups.
Mais à long terme, les fondamentaux restent solides :
des bénéfices d’entreprise en hausse,
une politique monétaire redevenue favorable,
et un niveau de liquidité élevé dans les portefeuilles des investisseurs.
Cette combinaison plaide pour une poursuite du cycle haussier, même si le rythme devrait se normaliser. Une consolidation temporaire permettrait d’ailleurs aux bénéfices de rattraper des valorisations devenues exigeantes, sans remettre en cause la tendance de fond.
En conclusion : un bull market toujours debout
Trois ans après son point de départ, le marché haussier américain semble encore avoir de belles années devant lui.
L’inflation se calme, la Fed assouplit sa politique, et les profits des entreprises tiennent bon malgré les vents contraires.
Le mouvement pourrait donc se prolonger en 2026, avec une croissance des bénéfices appelée à remplacer la revalorisation des multiples comme principal moteur de performance.
Dans ce contexte, les investisseurs gagneraient à rester exposés aux actions, tout en rééquilibrant leurs portefeuilles vers les secteurs et régions jusque-là négligés.
Le bull market, lui, n’a pas dit son dernier mot, il entame simplement une nouvelle étape, plus mature, mais toujours constructive.
🏠 Immobilier : Que contient vraiment le nouvel amendement sur le statut du bailleur privé ?
Le gouvernement vient de franchir une étape clé dans sa promesse de relancer l’investissement locatif. Le jeudi 23 octobre 2025, un amendement créant un « statut du bailleur privé » a été officiellement déposé à l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances 2026.
L’objectif affiché : redonner envie aux particuliers d’investir dans le logement, à un moment où le marché locatif est paralysé par la baisse des rendements, la hausse des coûts et la complexité réglementaire.
Un contexte d’urgence pour l’investissement locatif
L’initiative intervient alors que l’investissement locatif des particuliers est au plus bas depuis plus de dix ans. En cause : l’érosion de la rentabilité nette, la fin des dispositifs Pinel, et la montée en puissance des contraintes énergétiques.
Le gouvernement, conscient du risque de pénurie locative durable, souhaite à travers ce nouveau statut rétablir la confiance entre les investisseurs privés et la politique du logement.
Le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, avait promis un dispositif avant la fin d’octobre : la promesse est tenue, même si le texte reste pour l’heure moins ambitieux que prévu.
Un amortissement fiscal de 2 % pour le neuf
Le cœur du dispositif repose sur un mécanisme d’amortissement fiscal.
Concrètement, les propriétaires de logements neufs mis en location pourront déduire chaque année 2 % de la valeur du bien (hors foncier) de leurs revenus locatifs imposables, soit jusqu’à 80 % du montant total sur 40 ans.
Cet avantage vise à alléger la fiscalité sur les loyers tout en stimulant la construction neuve, dans un contexte de forte baisse des permis de construire.
Mais la mesure est bien en deçà des recommandations du rapport parlementaire Daubresse-Cosson, publié en juin, qui préconisait un amortissement de 5 % sur vingt ans, avec un bonus supplémentaire pour les loyers abordables.
Un avantage aussi prévu pour l’ancien… mais flou
Le dispositif prévoit également un amortissement pour les logements anciens, à condition que le propriétaire engage des travaux de rénovation.
Toutefois, aucun détail n’a encore été communiqué sur les modalités :
quel sera le taux d’amortissement appliqué ?
quelle proportion minimale de travaux sera exigée ?
et surtout, y aura-t-il une condition de plafonnement des loyers ?
Le ministère du Logement a précisé que ces points feront l’objet de débats parlementaires, laissant la porte ouverte à des sous-amendements susceptibles de renforcer le dispositif.
Une incitation fiscale encadrée
L’ensemble du mécanisme repose sur des conditions strictes :
le logement devra être loué à titre de résidence principale pendant au moins neuf ans ;
le montant de l’avantage fiscal ne pourra pas dépasser 5 000 euros par an et par bien ;
les travaux devront viser une amélioration énergétique significative lorsqu’il s’agit de logements anciens.
L’amendement inclut également la prolongation de deux ans du doublement du déficit foncier, soit jusqu’au 31 décembre 2027. Cette mesure, initialement prévue jusqu’à fin 2025, permet d’imputer jusqu’à 21 400 euros de déficit foncier par an sur le revenu global, à condition que les travaux permettent de sortir le logement du statut de “passoire énergétique”.
Un texte jugé trop timide par les professionnels
Si l’annonce du gouvernement a été saluée pour sa rapidité, la réaction du secteur est restée mitigée.
La Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) a dénoncé dans un communiqué un « rendez-vous manqué pour le logement », estimant que la mesure est « largement insuffisante au regard de la gravité de la crise ».
Selon la FNAIM, ce dispositif ne répond pas à l’enjeu central, qui consiste à mobiliser le parc existant et à relancer la construction privée.
Elle plaide pour un « choc de confiance », jugeant que le temps des demi-mesures est désormais révolu.
Les professionnels regrettent notamment :
un amortissement trop faible pour le neuf,
l’absence de cadre clair pour l’ancien,
et un plafond d’avantage fiscal jugé trop bas pour susciter un véritable effet d’entraînement.
Un débat parlementaire décisif à venir
Le gouvernement présente cet amendement comme une « base commune de discussion » et non un dispositif figé.
Le ministère de la Ville et du Logement a rappelé dans son communiqué du 24 octobre :
« Le gouvernement propose, les parlementaires votent. Cet amendement constitue un point de départ pour répondre à un enjeu majeur pour les Français : restaurer la confiance et redynamiser le parc locatif. »
Plusieurs amendements alternatifs sont attendus, notamment celui du député Salvatore Castiglione (UDI), suppléant de Valérie Létard, qui prendra officiellement son siège le 6 novembre.
Les discussions à l’Assemblée nationale pourraient donc faire évoluer sensiblement le contenu du futur statut du bailleur privé.
En attendant, un signal politique plus qu’un vrai choc
À ce stade, l’amendement gouvernemental reste avant tout un signal politique destiné à montrer la volonté de l’exécutif d’agir face à la crise du logement.
Mais pour les investisseurs privés, l’attractivité réelle du dispositif dépendra des arbitrages à venir : taux d’amortissement, nature des travaux, conditions de loyers, ou encore stabilité fiscale dans le temps.
Le gouvernement promet par ailleurs la présentation d’un plan d’urgence pour le logement dans les prochaines semaines, censé compléter ce premier texte et proposer des mesures structurelles pour redynamiser la construction et la rénovation.
En résumé : un premier pas, mais encore beaucoup d’attente
Le statut du bailleur privé marque une tentative de relance du marché locatif individuel, en redonnant un avantage fiscal modéré mais ciblé.
Si la mesure va dans le bon sens, elle reste en dessous des attentes du secteur et des propositions parlementaires.
Sa réussite dépendra désormais de la capacité du gouvernement et des députés à trouver un compromis entre rigueur budgétaire et attractivité pour les investisseurs.
En attendant les débats, le signal reste timide : il faudra davantage qu’un amortissement à 2 % pour déclencher un véritable retour de la confiance sur le marché locatif.
💸 Les annonces d’entreprises à noter de la semaine :
Kering vend sa division beauté à L'Oréal pour 4 milliards d'euros. L'Oréal récupère Creed ainsi que les principales licences du groupe (Bottega Veneta et Balenciaga immédiatement et Gucci à la fin de l'accord avec Coty).
BNP Paribas reconnu complice des violences au Soudan par un jury new-yorkais.
Oliver Blume va se consacrer pleinement à sa fonction de patron de Volkswagen jusqu'en 2030 en lâchant la présidence de Porsche AG.
Apple obtient les droits TV de la F1 aux Etats-Unis pour 5 ans.
Atos abaisse son objectif de ventes annuel.
Eurofins affiche une croissance organique du chiffre d'affaires de 4% sur 9 mois.
Edenred confirme ses prévisions après un T3 plus élevé que prévu. Par ailleurs, le groupe et Visa annoncent un partenariat pour accélérer l'innovation dans les domaines des avantages aux salariés, de la mobilité et des solutions de paiement B2B.
Un éventuel rachat d'Armani par LVMH ne fait pas l'unanimité dans la famille Arnault, selon La Lettre.
Assa Abloy réalise des résultats légèrement supérieurs aux attentes au troisième trimestre.
Les bénéfices trimestriels de CATL s'envolent.
L'Oréal prévoit toujours une progression de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité sur 2025.
Hermès enregistre une accélération de sa croissance organique
Vivendi affiche des revenus en recul de 2% au troisième trimestre.
LVMH envisage de vendre ses 50% dans Fenty Beauty, la marque de Rihanna, selon Reuters.
Heineken affiche un chiffre d'affaires en baisse au troisième trimestre.
Airbus, Thales et Leonardo signent un protocole d'accord pour créer un géant européen des satellites.
Nokia publie des résultats du T3 au-dessus des attentes.
Adobe a discuté de l'acquisition, pour 3 milliards de dollars, de la start-up Synthesia spécialisée dans la vidéo assistée par ordinateur, selon The Information.
Sanofi enregistre une hausse de ses bénéfices et maintient ses prévisions.
BNP Paribas et Société Générale feraient partie du syndicat bancaire qui a souscrit le nouveau financement record de 38 milliards de dollars d'Oracle.
Source : Les Echos, Investir, Investing, ZoneBourse, Reuters, ABC Bourse